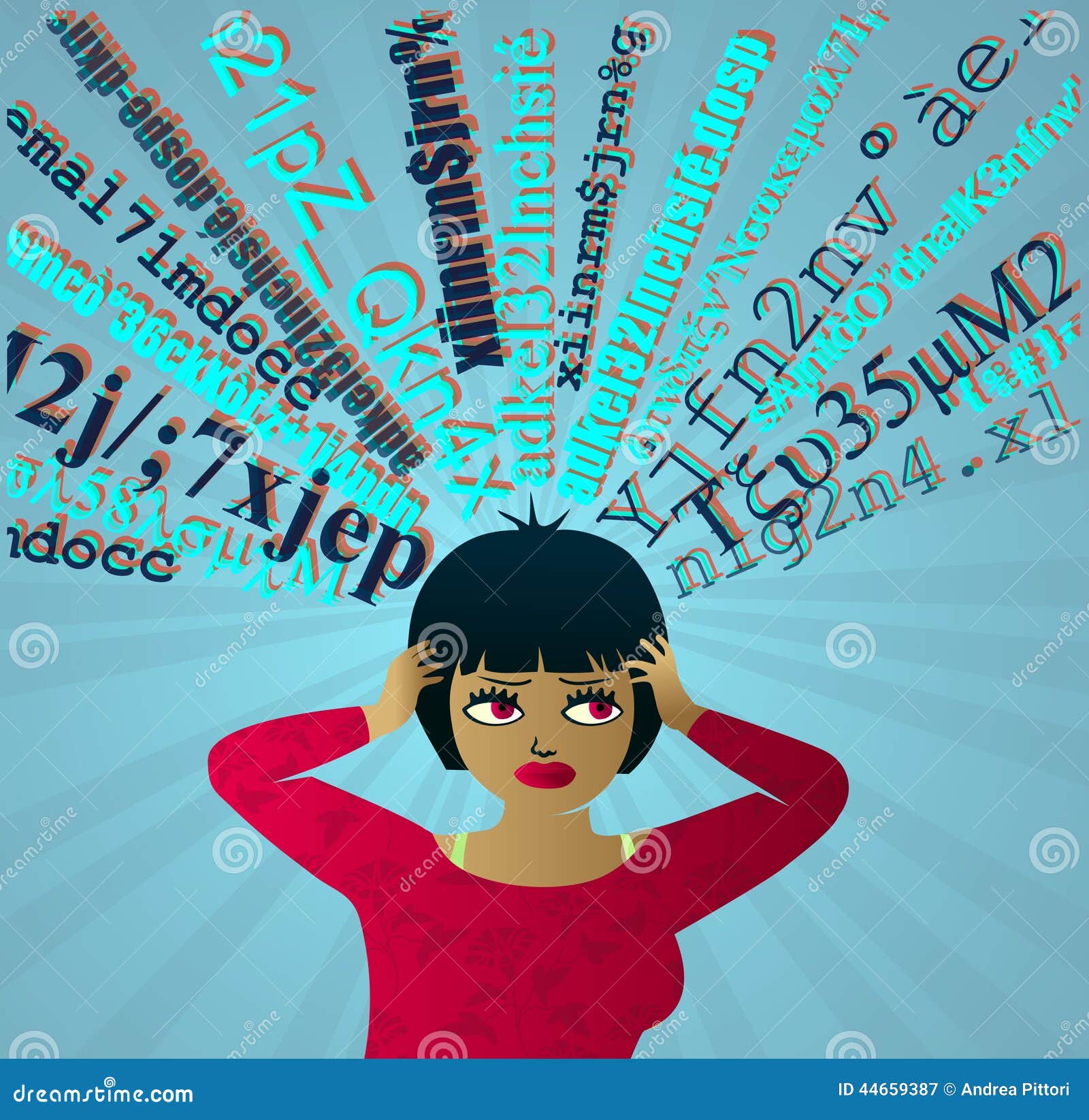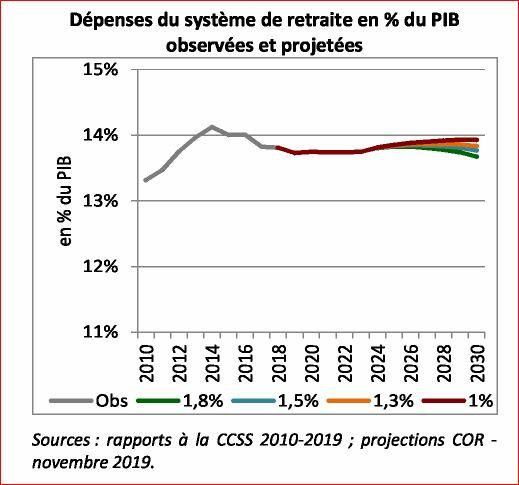Lire aussi Où en est la démocratie ? Le match Pinker-Mounk
Le Point : Encore un livre sur le populisme ? C'est presque devenu un genre en soi…
Pierre Rosanvallon : Il y a effectivement un très grand nombre de livres publiés sur le populisme, mais ils appartiennent à deux catégories. La première essaie d'analyser la montée en puissance des mouvements populistes dans le monde en l'expliquant par le fait que l'offre politique actuelle ne prend pas en compte tout un ensemble de questions sociales, de peurs individuelles et d'attentes démocratiques. Ces essais considèrent le populisme comme un symptôme des dysfonctionnements économiques, politiques ou sociaux. On associe ainsi la réflexion sur le populisme à une dénonciation des inégalités galopantes en économie ou à une mauvaise représentation politique. La deuxième catégorie de livres fait une critique du populisme comme étant destructeur des démocraties libérales. Par exemple ceux de
Yascha Mounk ou Jan-Werner Müller, qui sont très intéressants. Mais tous ces ouvrages oublient l'objet central : comprendre le populisme non pas simplement comme réaction ou une menace, mais comme une proposition politique, une vision de la société. Si on veut critiquer le populisme, il faut d'abord le définir. Mon livre se distingue en cela qu'il propose une théorie du populisme qui s'avère paradoxale. Tous les grands mouvements idéologiques – libéralisme, socialisme, communisme, conservatisme… – ont été liés à des œuvres fondamentales – celles d'
Adam Smith, Jaurès, Marx ou Burke… Le populisme n'a pas eu son grand intellectuel.
Si ce n'est Chantal Mouffe et Ernesto Laclau qui ont théorisé un populisme de gauche…
Ce sont les seuls à avoir présenté une esquisse de théorie du populisme. Issus d'une tradition marxiste, ils ont abandonné la lutte des classes et le prolétariat pour le « peuple », opposé à une « oligarchie ». Mais Laclau et Mouffe ont essentiellement analysé le populisme en termes d'antagonisme dans la société entre « les 1 % » et les « les 99 % », « eux » contre « nous ».
Les mouvements ou régimes populistes sont des grands manipulateurs d'émotions.
Quels sont pour vous les critères décisifs définissant les populismes ?
Il y a d'abord une vision de la société, avec l'opposition entre « peuple », en supposant qu'il s'agit d'un bloc homogène, contre « l'élite », « le système », « la caste ». Deuxième point essentiel : la question de la représentation. Le populisme fait la critique des partis politiques qui ne représenteraient plus la société. À ces corps intermédiaires, le populisme préfère le principe d'incarnation, c'est-à-dire avec un leader, un « homme-peuple ». Cette notion a été ressassée par Jorge Eliécer Gaitan dans la Colombie des années 1930-1940, un pionnier qui a été autant admiré par Castro que par Peron ou Chavez. Au passage, s'il est aujourd'hui difficile de représenter la société politiquement, c'est qu'on n'est plus simplement dans une société de classes, où le monde ouvrier faisait bloc, avait sa culture et son habitat, de même que pour les paysans ou les petits commerçants. Désormais, nous sommes dans une société où ce que nous avons en commun n'est plus des groupes sociaux, mais des communautés d'expériences et d'épreuves. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, qui n'étaient pas une classe sociale, car on y trouvait des salariés, des chômeurs, des commerçants…
Le troisième critère, c'est la démocratie directe et polarisée. Dans les populismes, le référendum est vu comme la procédure démocratique par excellence. D'où par exemple l'omniprésence du RIC chez les Gilets jaunes. Mais au Front national, dès les années 1970, le référendum était au cœur de la réflexion de proches de Jean-Marie Le Pen, qui voulaient s'inspirer de la Suisse. Or, si le référendum est la forme d'expression supérieure de la démocratie, il est limité par deux choses. Le référendum est une décision instantanée, alors que la démocratie se définit comme la construction d'une volonté générale. Si la représentation politique est indispensable, c'est aussi parce qu'on a besoin d'une fonction réflexive. Et très souvent, le référendum ne prend pas en compte dans son énoncé les conditions de sa mise en œuvre. Exemple typique : le Brexit. On vote pour une décision, mais on ne sait pas comment faire ce Brexit. Autre date clé : le référendum de 2005. En votant « contre », que fallait-il en tirer comme conclusion ? Fallait-il que la France se retire de l'Union européenne ? On a préféré faire glisser le problème en passant d'une constitution à un traité. Le fait de sacraliser le référendum nous fait ainsi perdre de vue que c'est un instrument dont les conditions de validité tiennent à sa solennité et à son irréversibilité. Si une majorité électorale change, on peut changer de politique et revenir sur la politique de la majorité précédente. Mais il est difficile de revenir sur un référendum, comme on le voit avec le Brexit, car cela supposerait que la volonté du peuple erre, comme dirait Rousseau. Le référendum est ainsi un instrument démocratique incontournable, mais dont l'usage doit être soigneusement réfléchi.
Quatrième critère : les populismes ont en commun de penser que l'économie est aux mains de puissances internationales négatives, et que pour régler les questions économiques, il faut le retour à la souveraineté de la décision. Le populisme est ainsi un national-protectionnisme, défendant une souveraineté illimitée. Enfin, cinquième point : le populisme accorde une importance inédite au rôle joué par les émotions et les passions en politique. C'est peut-être le point le plus positif du populisme. Les mouvements ou régimes populistes sont des grands manipulateurs d'émotions. Mais en même temps, il est important de reconnaître qu'il n'y a pas que les intérêts et la raison dans les sociétés humaines. Au Collège de France, nous avons un grand spécialiste des neurosciences, Stanislas Dehaene, qui montre bien qu'en termes cognitifs, on ne peut pas distinguer les questions d'émotion et de raisonnement.
Lire aussi Phébé – Démocraties au bord de la crise de nerfs
Pourquoi cette définition du populisme est-elle si importante pour vous ?
Si on veut critiquer le populisme, il faut le faire en ayant bien conscience de ce qu'il est. Il est ainsi idiot de lui reprocher d'être illibéral, alors même que le populisme se glorifie de l'être, estimant qu'il faut dépasser les démocraties libérales qui ne seraient pas accomplies. Me rendant fréquemment dans les pays d'Amérique latine, j'ai toujours été frappé par le fait que des opposants à des régimes populistes en place dépeignent les dirigeants comme des « clowns ». Chavez était peut-être un clown, mais il a gagné des élections avec une idéologie. Il faut argumenter sur le fait que les populismes veulent restreindre certaines libertés, qui sont pour eux des limitations à la volonté du peuple. C'est ce que dit aujourd'hui Trump quand il affirme que la procédure d'impeachment est une insulte à ses électeurs. Les questions juridiques sont pour les populistes d'ordre secondaire. Pour eux, tout est devenu politique.
Lire aussi Phébé – Pourquoi le populisme n'est pas le nouveau fascisme
Les Gilets jaunes sont pour vous d'inspiration populiste, mais ils ont coupé toutes les têtes qui dépassent au sein de leur mouvement…
Il faut faire distinction entre une atmosphère populiste et des mouvements populistes constitués. Dans les régimes populistes, le « peuple » est incarné par un leader. Le mouvement des Gilets jaunes, lui, a participé à l'atmosphère populiste contemporaine, mais n'a pas été un mouvement populiste au sens strict du terme. Le dégagisme y a été plus fort que l'attente d'une incarnation politique. Cela n'a pas été un mouvement orienté vers un projet politique, mais un mouvement de type existentiel, de manifestation et de protestation concernant une difficulté. C'est pour cela que même le terme « mouvement social » est discutable concernant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ce n'est pas une projection dans l'avenir, ce sont des rassemblements manifestant une présence, notamment au cœur des grandes villes. Ils ne manifestaient même pas d'un point à l'autre, ils erraient.
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ce sont deux mondes qui ne se rejoindront jamais.
Emmanuel Macron lui-même est-il d'une certaine façon une figure populiste ?
Macron a été élu sur la base du dégagisme. Il s'est défini comme celui étant en dehors du système, novice en politique. Être un homme vierge, c'est ce qui a fait son succès. Et c'est pour cela que tous ceux qui veulent aujourd'hui revenir, de François Baroin à Ségolène Royal, me paraissent avoir de faibles chances…
Va-t-il y avoir une convergence entre les populismes de gauche et de droite ?
Si on prend le cas français avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a un abîme insondable en termes d'histoire personnelle entre la fille de Jean-Marie Le Pen et un ancien trotskiste devenu sénateur socialiste et franc-maçon. Ce sont deux mondes qui ne se rejoindront jamais. En revanche, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon partagent tout un ensemble d'éléments de langage sur le dégagisme, le souverainisme économique, la démocratie immédiate et l'opposition aux élites. Mais un élément central les distingue toujours : la question de l'immigration. Dans les populismes latino-américains dont s'inspire Mélenchon, cette question s'avère secondaire car ce n'est pas le même enjeu qu'en Europe. On voit d'ailleurs l'évolution de Mélenchon, qui a remis l'accent sur l'importance de la place accordée aux immigrés, sur une vision humaniste. Mais en même temps, au sein de son électorat, il y a une vraie porosité. Dès lors que l'immigration n'est plus envisagée comme un droit de l'homme ou une assistance aux personnes en danger, mais comme voulue par le grand capital pour faire plier le salariat, on peut s'y opposer à gauche au nom de l'anticapitalisme. On l'a bien vu en Allemagne quand Sahra Wagenknecht, dissidente de Die Linke, avait orienté son discours là-dessus. Comme l'a montré récemment le
JDD, 33 % de l'électorat de la gauche radicale (France insoumise et PCF) en 2014 ont voté pour la liste du RN aux dernières élections européennes. C'est frappant. La convergence entre les populismes ne se fera ainsi pas par les personnalités politiques, mais par des rapprochements d'éléments de langage et par la porosité entre les électorats.
Au final, n'est-ce pas le populisme de droite qui finit par en profiter ?
Pour une raison simple : à partir du moment où le marqueur de l'immigration apparaît comme étant au cœur de la vision de l'économie et de la société, c'est le populisme de droite qui l'importe. Mais c'est aussi dû au fait que le populisme de gauche ne présente aucun progressisme, aucune vision nouvelle, simplement un dégagisme…
Le député peut ainsi se voir reprocher ses 5 000 euros mensuels, alors que le sportif ou l'artiste, dont les revenus sont cent ou mille fois supérieurs, suscitent beaucoup moins d'hostilité.
Mélenchon n'hésite pas à se réclamer du césarisme…
En 2017, visitant le Forum romain, il expliquait que « César était proche du peuple. C'est les patriciens, les ennemis du peuple, qui l'ont assassiné. Ce qui est intéressant, c'est de voir César comme une figure populaire ». Mélenchon a bien retenu de Laclau et Mouffe que la fonction d'incarnation est puissante, et qu'il faut la cultiver. Alors que par sa formation, il est aux antipodes de cela. La culture franc-maçonne et socialiste – il a quand même été le plus jeune sénateur français – se méfie des personnalités excessives, comme le disait Gambetta. C'est ainsi un revirement complet. Il y a eu un moment Mélenchon, comme l'a montré son résultat en 2017. Il a su superposer une image paternaliste avec une image dégagiste, une image républicaine – presque hugolienne – avec une image gauchiste.
Pourquoi la critique des « 1 % », devenue un leitmotiv dans les populismes de gauche, vous semble-t-elle absurde ?
Les 1 % constituent un monde hétérogène. Les 0,9 % les plus riches ne vivent pas dans le même monde que les 0,1 % et plus encore les 0,01 %. Et dans les très grandes fortunes, il y a celles reçues par héritages, tandis que d'autres sont dues à l'innovation ou au talent. Les héritiers peuvent être tenus en suspicion, là où les grands créateurs n'ont pas la même image négative. Si on regarde les vingt plus hauts salaires français, il y a huit footballeurs. Le salaire moyen en Ligue 1 est de 73 000 euros net par mois. Le député peut ainsi se voir reprocher ses 5 000 euros mensuels, alors que le sportif ou l'artiste, dont les revenus sont cent ou mille fois supérieurs, suscite beaucoup moins d'hostilité. Quant au 1 %, n'oubliez pas qu'en 2015, il fallait avoir un revenu net de 8 850 euros par mois pour entrer dans le club.
Lire aussi Oxfam : Mélenchon dénonce les 1 % les plus riches… mais il en fait partie
Éric Zemmour a recensé votre livre en saluant l'analyse, mais en vous reprochant de sous-estimer le rôle du rejet de l'immigration dans la vague populiste. Un politologue comme Eric Kaufmann, auteur de Whiteshift, estime lui aussi que l'immigration et les changements démographiques sont le facteur premier du Brexit comme de l'élection de Trump…
Cela fait longtemps que je m'intéresse à cette question avec une profondeur de champ historique. Ce qui est frappant, c'est que les visions identitaires sont apparues comme une façon de penser l'égalité, en sous-estimant d'autres inégalités. Aux États-Unis, les politiques de ségrégation ont été mises en place vingt ans après la guerre de Sécession, ce qui a introduit une égalité entre riches et petits Blancs sur ce sujet. Le rapport à l'immigration relève de ce registre. Je ne nie pas l'importance de ces questions. Mais dans l'usage politique qu'en font les populistes à droite, c'est une façon de dire que les différences économiques sont secondaires par rapport à l'égalité entre Français de souche. Regardez l'Inde de Modi, où la question des castes est balayée par l'appartenance hindoue. J'ai aussi été très frappé de voir le moment où Maurice Barrès bascule en passant du socialisme de sa jeunesse au nationalisme, qu'il présente comme l'accomplissement de son socialisme. Il le définit dans un livre de 1893,
Contre les étrangers, où il lie cela à une philosophie de la solidarité et de l'égalité.
Lire aussi Éric Zemmour : « La plupart des historiens n'assument plus l'histoire de France »
Si on vous suit, les peurs liées à l'immigration ne seraient que le fruit de manipulations politiques ?
Les questions liées à l'islam ou aux normes de la civilité sont fondamentales dans notre société, elles ne se résument d'ailleurs de loin pas à l'immigration. Mais l'immigration en tant que telle présente cette particularité qu'elle est un phénomène qu'on tient en suspicion de manière générale, mais qu'on tolère en particulier. Même chez des militants du RN, si vous leur parlez de leur voisin étranger, ils vont vous dire : « Ah lui, c'est une exception », parce qu'ils mettent un visage sur un phénomène général présenté comme une menace. Alors que la démocratie, c'est justement de passer d'une vision par catégories générales à une connaissance réelle des individus.
Napoléon III rappelait que les journalistes ne sont pas des élus, mais des pouvoirs privés, autoproclamés, qui entendent jouer un rôle d'ordre public.
En quoi Napoléon III a-t-il été un pionnier en matière de populisme ?
C'est avec lui que s'est faite la première théorisation de la démocratie illibérale. Napoléon III est le premier à avoir expliqué que la démocratie pouvait par exemple impliquer la limitation de la liberté de la presse. Le régime du Second Empire faisait une différence entre l'expression par livre et par journaux. Pour les livres, la liberté était totale parce que cela émanait de personnes. Alors que les journaux remplissent une fonction publique de formation de l'opinion. Napoléon III rappelait que les journalistes ne sont pas des élus, mais des personnes qui mobilisent leur talent et gagnent la confiance de capitalistes, constituant ainsi des pouvoirs privés, autoproclamés, qui entendent jouer un rôle d'ordre public. Un de ses partisans a même publié un livre,
L'Aristocratie des journaux, expliquant qu'ils sont une structure capitaliste antidémocratique. Napoléon III a ainsi construit la démocratie comme un rapport entre lui et le peuple, qui passait notamment par des voyages en province. De même, aujourd'hui, l'un des points communs entre les régimes et les mouvements populistes est de crier haro sur les médias, accusés d'être des faussaires de la démocratie. Dans les pays de l'Est, Orban ou le PiS ne disent pas ouvertement qu'ils sont contre la liberté de la presse. Mais en Pologne, toutes les entreprises publiques ont par exemple interdiction de faire publicité dans des journaux indépendants. En Hongrie, 80 % des journaux sont aux mains de capitaines d'industrie proches d'Orban. Napoléon avait théorisé cela de manière positive, de la même façon qu'il s'opposait aux partis politiques en les qualifiant d'entrepreneurs privés. Pour lui, la démocratie devait être immédiate, sans interface. On retrouve son influence dans la critique du « deep state » par les partisans de Trump, qui voient des ennemis du peuple déguisés en fonctionnaire qui ont mis la main sur ce qui appartient au public. Ce serait une privatisation masquée.
Vous insistez sur la nature irréversible des régimes populistes, qui passe par les référendums ou par le goût pour les assemblées constituantes…
C'est l'élément qui caractérise le passage, dans les régimes populistes, de la démocratie illibérale vers les démocratures. Cela ne passe pas que par le référendum, c'est aussi le fait de renouveler les mandats de façon indéfinie. C'est le cas de Maduro, alors que Chavez avait lui accepté un référendum de révocation (qu'il a gagné). En Bolivie, Evo Morales a aussi essayé d'organiser son irréversibilité, mais a échoué. Poutine vient de déclarer qu'il réfléchissait à une solution constitutionnelle pour se représenter, la Constitution russe ne prévoyant que deux mandats consécutifs de président. En 2024 se terminera son deuxième mandat pour la deuxième fois. En démocrature, il y a toujours une élection, mais qui n'obéit plus qu'à la seule règle de l'absolutisation du suffrage.
Lire aussi Amérique latine : la chute de la gauche Manu Chao
Votre livre est passionnant dans son diagnostic, mais les réponses semblent maigres. Il faut selon vous « complexifier la démocratie ». C'est-à-dire ?
Au lieu de vouloir simplifier et polariser la démocratie, il faut faire l'inverse ! Bien sûr, il faut garder les formes de représentation parlementaire classique, mais il faut aussi mettre en place des représentations de ce qu'on appelle l'homme quelconque. Le tirage au sort n'est pas un substitut à l'élection, c'est une modalité supplémentaire.
Vous croyez vraiment qu'il est utile de tirer au sort 150 personnes pour une Convention citoyenne pour le climat, alors qu'elles n'ont aucune compétence en la matière ? Je vous rappelle qu'une majorité de Français pense que le nucléaire contribue au réchauffement climatique…
Par définition, ces gens ne sont pas compétents sur ces sujets. Mais le pari de ces assemblées, c'est de se dire que si ces personnes se rassemblent, passent ensemble des journées à écouter des experts, lisent des rapports, leur information va évoluer et leur vision du problème va être plus complexe, davantage liée à des éléments de choix rationnels. Toutes les expériences montrent, à l'image des jurys citoyens sur la vaccination, que les points de vue changent. Ces assemblées tirées au sort sont ainsi très positives. Le problème, c'est comment communiquer ces changements personnels au reste de la société. Ces expériences de tirages au sort n'ont ainsi de sens que si on trouve un moyen de communication entre ces assemblées et la société. Cela passe-t-il par des séances télévisées, des publications ? Une chose est certaine : avoir des citoyens qui prennent le temps de s'informer, réfléchissent, sont confrontés à des points de vue différents répond à l'idéal de Condorcet d'une société de citoyens rationnels et informés. Car sinon, on va tomber dans ce paradoxe que, alors que nos sociétés sont de plus en plus éduquées, elles sont aussi de plus en plus sensibles au complotisme et aux fake news.
« Le Siècle du populisme », de Pierre Rosanvallon (Seuil, 275 p., 22 €).