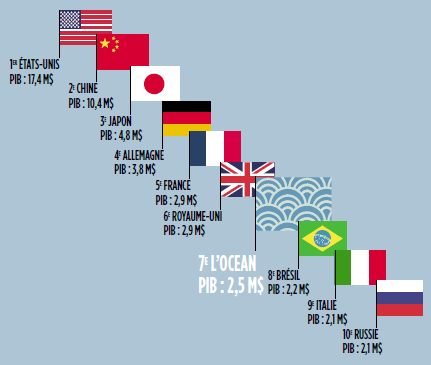
Plusieurs raisons expliquent pourquoi certains pays cherchent à exercer une puissance mondiale, et elles se combinent souvent. Voici les principales : Sécurité : En dominant les relations internationales, un pays prévient ou réduit les menaces contre lui. Une grande puissance à plus de moyens pour se défendre ou dissuader ses adversaires.
Intérêts économiques : La puissance permet d'accéder aux marchés, aux ressources naturelles, aux voies commerciales, et d'imposer des règles économiques favorables à ses entreprises.
Influence idéologique ou culturelle : Certains pays veulent propager leurs valeurs, leur modèle politique ou leur culture (comme les États-Unis avec la démocratie libérale ou la Chine avec le modèle autoritaire-mercantiliste).
Prestige et légitimité intérieure : Être reconnu comme une grande puissance renforçant le prestige international, mais aussi la légitimité du pouvoir politique à l'intérieur du pays. Cela flatte aussi l'opinion publique et renforce l'unité nationale. Poids historique ou mission perçue : Certaines nations se sentent investies d'une mission historique (civilisatrice, religieuse, idéologique…) ou veulent restaurer une grandeur passée (Russie, Chine, Turquie...).
Contrôle des règles du jeu international : Être puissant permet d'écrire ou d'influencer les règles (du commerce, du droit international, des alliances, des technologies, etc.) selon ses propres intérêts. Souvent, cette quête de puissance mondiale est aussi liée à la peur du déclin, ou à la compétition avec d'autres puissances émergentes.
Cas des États-Unis d'Amérique ?
Prenons le cas des États-Unis — c'est probablement l'exemple le plus emblématique de la quête (et de l'exercice) de la puissance mondiale.
Pourquoi les États-Unis veulent exercer une puissance mondiale ?
Sécurité et prévention des menaces Après avoir été relativement isolés jusqu'au début du XXe siècle, les deux guerres mondiales ont convaincu les États-Unis qu'ils ne pouvaient plus se désintéresser du monde. Leur puissance permet de prévenir l'émergence d'adversaires menaçants (URSS hier, Chine aujourd'hui), loin de leur territoire.
Domination économique
Le contrôle du commerce mondial, des technologies, de la finance (le dollar, Wall Street, les grandes entreprises) est au cœur de leur puissance. Ils défendent un ordre économique libéral qui sert leurs intérêts.
Diffusion de leur modèle
Les États-Unis ont longtemps promu la démocratie, les droits de l'homme, le capitalisme libéral, parfois sincèrement, parfois comme justification de leur interventionnisme. Le « soft power » américain est immense : cinéma, musique, universités, réseaux sociaux…
Contrôle des institutions internationales
Les États-Unis ont participé à la création des institutions clés après 1945 (ONU, FMI, Banque mondiale, OTAN), souvent en position dominante. Cela leur permet de peser sur les règles du jeu mondial.
Leadership contesté = risque de perte d'influence
Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis sont confrontés à l'érosion de leur suprématie : montée de la Chine, affirmation de puissances régionales (Iran, Turquie, Russie), fragmentation de l'ordre international. Ils cherchent donc à maintenir leur statut.
Raisons intérieures
Être une grande puissance donne du prestige au président, mobiliser les industries (militaire, technologique…), et peut détourner l'attention des problèmes internes.
Résultat ?
Les États-Unis ne cherchent pas seulement à défendre leur territoire : ils veulent façonner le monde à leur image, pour en tirer sécurité, prospérité et influence. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme libéral, souvent mêlé d'idéalisme… et de pragmatisme.
Est-ce le Déclin des USA ? Oui, beaucoup parlent aujourd'hui d'un déclin relatif des États-Unis — pas une chute brutale, mais une érosion progressive de leur domination. Voici les principaux signes et causes de ce déclin, sans catastrophisme mais avec lucidité :
1. Déclin relatif face à la montée d'autres puissances Chine : croissance économique, progrès technologique, influence internationale croissante (BRICS, Nouvelles Routes de la Soie…). Multipolarité : la Russie, l'Inde, la Turquie, l'Iran, et même l'Europe cherchent plus d'autonomie face à Washington.
2. Échecs stratégiques Irak, Afghanistan, Syrie, Libye : guerres coûteuses, peu concluantes, et souvent contre-productives. Cela a entamé la crédibilité du leadership américain, même chez ses alliés.
3. Division intérieure et instabilité politique
Polarisation extrême, violences politiques, crise de confiance dans les institutions. La démocratie américaine est perçue comme fragilisée, et comprenant de l'intérieur.
4. Déclin industriel relatif
à la Désindustrialisation, délocalisations massives (notamment vers la Chine). Même si la Silicon Valley reste puissante, les États-Unis dépendent de chaînes d'approvisionnement mondiales qu'ils ne contrôlent plus complètement.
5. Crise du multilatéralisme
Les États-Unis ont affaibli l'ordre international qu'ils avaient créé (retrait d'accords, mépris des institutions…). Cela a laissé le champ libre à d'autres acteurs pour influencer les règles (ex : la Chine à l'ONU ou dans l'OMC).
6. Fatigue impériale
L’opinion américaine elle-même est de moins en moins favorable à l’engagement international.
« America First » (Trump) reflète une tendance plus large : repli sur soi, méfiance envers les alliances, réduction des engagements.
No comments:
Post a Comment
Je tiens ce blog depuis fin 2005. Tout lecteur peut commenter sous email valide et sous anonymat. Tout peut être écrit mais dans le respect de la liberté de penser de chacun et la courtoisie. Je modère les commentaires.